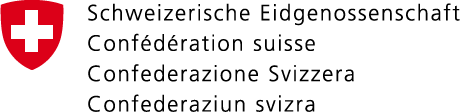Signore e Signori
Buongiorno a tutti
Je commencerai par une nuance : ce forum titre sur « l’échiquier mondial » … c’est vrai, le monde ressemble certes à un jeu d’échec, mais d’une autre nature : les joueurs se sont multipliés et les cases en noir et blanc ont fait place à de nombreuses nuances de gris, aux contours flous.
C’est d’ailleurs le constat très juste qui figure sur l’invitation que vous m’avez adressée, je cite : « de graves tensions redessinent les équilibres mondiaux et ces défis à la fois géopolitiques et économiques sont d’une rare complexité ».
En fait, nous voilà plutôt dans une dangereuse partie de poker. Et l’Europe se retrouve au centre de la table de jeu.
Au seuil de la nouvelle année, le peuple attend des conseillers fédéraux qu’ils insufflent à la nation un élan d’optimisme, tel un rituel ancestral destiné à chasser les mauvais esprits de l’hiver.
Pour le ministre des Affaires étrangères que je suis, cet exercice revêt une complexité particulière, tant l’état du monde, aujourd’hui marqué par les tumultes et les incertitudes, nous incite plutôt au pessimisme.
Et bien, entre un optimisme (un brin) naïf et un pessimisme (un peu) stérile, je choisis le réalisme lucide. Ce réalisme m’impose, chaque jour, d’agir avec courage et humilité pour servir ce pays que j’aime profondément : la Suisse. C’est précisément dans ce réalisme que je puise la force de persévérer et la conviction d’avancer.
Voici alors mon point de vue.
L'année écoulée a été un véritable banc d’essai mondial pour la démocratie.
En 2024, plus de 4 milliards de personnes ont été appelées aux urnes à travers 76 pays, soit plus de la moitié de la population mondiale. Parmi eux, plus de 1,5 milliard ont finalement exercé leur droit de vote.
Un authentique « test démocratique » à l'échelle universelle.
Quel est le résultat ? Examinons-le en sept points.
1. Méfiance généralisée
Les électeurs ont exprimé une méfiance généralisée à l'égard des dirigeants actuels.
2. Montée des populistes
Les partis populistes, surtout de droite, ont progressé, portés par une désillusion envers les centristes et un basculement des jeunes électeurs, notamment les hommes.
3. Crise économique et inflation
L'inflation et les inégalités générationnelles ont alimenté le mécontentement, renforçant des attitudes "à somme nulle".
4. Nouveaux médias
Des leaders populistes, comme en Indonésie et au Mexique, ont exploité au mieux les médias sociaux pour mobiliser largement.
5. Polarisation des jeunes
Les jeunes ont délaissé les partis traditionnels, se tournant massivement vers des alternatives radicales, à droite comme à gauche.
6. Tendances durables
Ces dynamiques devraient se poursuivre, avec des populistes prêts à gagner du terrain dans les prochaines élections mondiales.
7. Prochaines élections
Les prochaines élections dans des pays comme l’Australie, le Canada et l’Allemagne pourraient voir de nouveaux gains pour les populistes.
Mesdames et Messieurs,
Voici les faits.
Comment les interpréter à présent ?
Et avec quelles conséquences ?
Je vais vous donner ma réponse à quatre questions :
1. Le monde perd-il ses repères ?
2. Du jamais vu ?
3. Les populistes sont-ils coupables ?
4. Et la Suisse, dans tout cela ?
1. Le monde perd-il ses repères ?
Oui, il perd ses repères, surtout en Occident. La globalisation a réduit la pauvreté, mais elle a aussi engendré des poches de désindustrialisation, notamment dans les pays occidentaux. La révolution numérique a profondément transformé le marché du travail, accentuant la précarité de l’emploi. Parallèlement, la montée en puissance des revendications identitaires individuelles (ethnique, sexuelle et autres), bouscule les valeurs et les repères culturels, fragilisant ainsi nos racines. Ces bouleversements alimentent des tensions sociétales et politiques. Les réseaux sociaux exacerbent cette polarisation et influencent la gouvernance, tandis que les défis climatiques renforcent un sentiment de chaos, nourrissant une crise de confiance envers les dirigeants.
Ces bouleversements traduisent, à mon sens, une transition vers de nouveaux paradigmes sociopolitiques propres à l’ère numérique et post-globale. La belle époque de l’après-chute du mur de Berlin est révolue !
Nous avions interprété la fin de la guerre froide comme une victoire définitive de la démocratie, certains allant jusqu’à y voir la "fin de l’histoire".
Mais c’était une erreur. Ce fut certes la fin d’une époque, mais la suite n’a en rien répondu aux attentes.
Les signes avant-coureurs, pourtant nombreux, étaient déjà visibles, notamment en Italie dans les années 1990. Où cette transition nous mène-t-elle ? Nul ne le sait avec certitude, mais elle semble marquer à la fois la clôture de la révolution étudiante de mai ‘68 et la fin de l’ordre établi après la guerre froide.
2. Du jamais vu ?
Certes non ! L’histoire a cette fâcheuse tendance à se répéter. Mais pour en comprendre les dynamiques, il faut dépasser l’horizon d’une vie humaine. Remontons ainsi à 1453, à la chute de Constantinople, qui scella la fin de l’Empire romain d’Orient et ouvrit une nouvelle ère.
Cette conquête transforma Constantinople en capitale ottomane, mettant fin à plus de mille ans d’histoire byzantine.
Comment cela a-t-il été possible ?
Selon une légende, alors que la cité était sur le point de tomber, les intellectuels débattaient de questions futiles – comme le sexe des anges – au lieu de se concentrer sur la défense de leur ville.
Une ère touche à sa fin lorsque ceux qui en sont les garants, convaincus que tout leur est acquis, se perdent dans des préoccupations dérisoires et des quêtes personnelles.
Autrefois comme aujourd’hui, en gravissant les échelons de la pyramide de Maslow, qui établit la hiérarchie des besoins humains, les sociétés évoluent d’une logique axée sur la performance vers une société d’attentes, où l’État assume l’intendance, permettant à l’individu de se consacrer à son accomplissement personnel, comme l’illustre le concept de "work-life balance".
Et pourtant, aujourd’hui, nous sommes aussi encerclés par un « ring of fire » : guerre en Ukraine, troubles dans les Balkans et le Caucase, conflits au Moyen-Orient, instabilités en Afrique du Nord et putschs en Afrique subsaharienne (RDC / Rwanda). Ces crises, amplifiées par le réchauffement climatique, annoncent une catastrophe mondiale.
L’histoire se répète, et il serait sage d’en prendre conscience pour affronter l’avenir.
3. Est-ce la faute des populistes si le monde perd ses repères ?
C’est une lecture que nous entendons souvent. Mais elle est superficielle et mélange les causes et les effets.
Le populisme est un symptôme, il n’est pas une maladie. La maladie sous-jacente est la perte de confiance entre la population et l'élite.
La mondialisation a produit des gagnants et des perdants. Beaucoup de citoyens, déçus par la politique, ont pointé du doigt les élites, les accusant d’être insensibles à leurs problèmes et trop occupées par des discussions… sur le sexe de anges.
Ce mécontentement croissant a engendré des mouvements, qualifiés de « populistes » - avec une connotation péjorative - par les élites elles-mêmes.
Initiées dans les années 1990 par Berlusconi en Italie, dans le contexte des bouleversements idéologiques post-chute du mur de Berlin, ces « révolutions populistes » se sont diffusées à travers le continent, oscillant entre avancées et reflux, jusqu’à culminer avec l’arrivée au pouvoir de figures comme Trump.
Ces révolutions sont également apparues en réaction à un glissement idéologique vers des utopies telles que le « salaire sans travail », où l’épanouissement personnel prime sur l’effort, reflet d’individus en quête d’équilibre intérieur plutôt que de performance.
Ces bouleversements sont en train de redessiner la géographie du pouvoir. Ils ont polarisé le débat public, exacerbé les divisions idéologiques et renforcé les positions extrêmes. Dans une société fragmentée, le dialogue tend à s’épuiser, le compromis est perçu comme une faiblesse, et la politique devient un champ de bataille où le conflit ouvert domine.
Nous en observons les conséquences aux États-Unis, en France, en Allemagne, et bien au-delà : la polarisation s’installe partout.
Cependant, il serait simpliste de diaboliser la polarisation. Comme tout phénomène social, elle possède une double facette.
À bien des égards, la polarisation est inhérente à la démocratie. Dans des proportions modérées, elle reflète la pluralité des opinions, qui fait la richesse et la vitalité des sociétés démocratiques. Mais elle peut aussi déraper.
C’est un peu comme un médicament : à petites doses, cela agit comme un stimulant bénéfique, mais en excès, cela devient un poison toxique.
La démocratie implique la divergence et le débat, mais elle exige aussi le respect des opinions d’autrui. Sans cet équilibre, le système risque de s’effondrer.
4. Et la Suisse, dans tout cela ?
En Suisse, la polarisation politique, bien que plus subtile et modérée qu’ailleurs, grâce au système consensuel de démocratie directe et de gouvernance collégiale, a suivi certaines tendances notables :
a) Montée des extrêmes : Depuis les années 1990, les approches idéologiques ont gagné en influence par rapport aux approches pragmatiques.
b) Divergences sociétales : Les débats sur l’immigration, l’environnement, l’orientation sexuelle, le bien-être des animaux, les relations avec l’UE etc. ont creusé des clivages entre les régions linguistiques, les zones urbaines et les zones rurales, les zones de frontières et les zones centrales.
c) Evolution de la démocratie directe : Les référendums, piliers du système suisse, ont parfois accentué les tensions sur des sujets sensibles, par ex. : l’initiative anti-minarets (2009), celles sur le renvoi des étrangers criminels (2010), sur les multinationales responsables (2020), ou sur le mariage pour tous (2021), etc.
d) Fragmentation politique : Le consensus autrefois dominé par les grands partis (PLR, PDC, PS) s’effrite avec l’apparition de nouvelles forces.
Cette évolution a pris racine en Suisse dans les années 1990 avec l’émergence d’un style politique populiste, initié par la Lega dei Ticinesi et influencé par l’Italie. D’abord marginal, ce mouvement s’est progressivement étendu à l’échelle nationale, adoptant diverses formes, tant à gauche qu’à droite. Il a ainsi accentué les clivages idéologiques, souvent réduits à l’opposition entre une droite nationaliste et une gauche wokiste.
Toutefois, les mécanismes institutionnels suisses, tels que le fédéralisme, la représentation proportionnelle et la gouvernance par coalition, ont jusqu’ici permis d’atténuer les effets de la polarisation et d’éviter une déstabilisation excessive.
Mais la polarisation ne se limite pas aux sociétés au sein des États ; ces dernières décennies, elle s’est aussi exacerbée entre nations. Les pays du Sud global, désormais affranchis de l’extrême pauvreté, revendiquent un rôle plus influent dans un système qu’ils jugent biaisé en faveur des anciennes puissances.
À New York, au Conseil de sécurité de l’ONU, j’ai pu observer cette dynamique à l’œuvre, reflet d’un monde multipolaire en pleine émergence, héritage direct de la fin de la guerre froide.
Mesdames et Messieurs, chers invités
Le monde traverse des turbulences et la Suisse ne peut s’en isoler. Même en cas de « dérive des continents », nous resterions indéfectiblement liés à l’Europe.
C’est pourquoi, stabiliser et moderniser nos relations avec l’UE constitue, pour le Conseil fédéral, une priorité stratégique.
L’horizon mondial reste flou, tandis qu’un nouvel ordre se dessine sans contours précis.
Les récentes déclarations du président américain et les réactions des grandes puissances n’ont fait qu’accentuer cette incertitude.
Dans ce contexte, nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de fragiliser ultérieurement les relations avec nos voisins, dont le marché est essentiel pour chacun d’entre vous ici.
Nous avons négocié avec l’UE un excellent accord. Il est temps d’avoir le courage de surmonter les derniers obstacles internes et de clore ce chapitre après vingt ans, favorisant ainsi notre stabilité pour les prochaines décennies.
Hésiter n’est plus une option.
Même après avoir stabilisé la voie bilatérale, le gros - en Suisse et dans le monde - restera à faire.
Je pense à la méfiance enracinée envers l’économie, à la productivité stagnante, aux attentes énormes en matière de redistribution, à la frénésie migratoire, à la déresponsabilisation répandue et au culte de l’épanouissement personnel. Autant de touches qui, mises bout à bout, esquissent un tableau impressionniste … et impressionnant (!) des défis sociaux actuels, propre aux pays occidentaux.
Ces symptômes ne sont pas de simples signaux d’alerte, mais un appel urgent à l’action. La Suisse ne peut se permettre de rester spectatrice. Son modèle, aussi robuste soit-il, doit s’adapter.
Cette nouvelle réalité mondiale doit guider toutes nos stratégies, publiques et privées.
Les priorités internes exigent d’abord de relever des défis majeurs comme :
· Réhabiliter le sens des responsabilités ;
· Modérer les attentes vis-à-vis de l’État ;
· Redonner sa valeur à la culture du compromis ;
· Consolider le système suisse de milice ;
· Stabiliser nos relations avec nos voisins ;
· Faire de la neutralité un levier stratégique et pragmatique.
· Renforcer notre défense ;
· S’engager en la faveur de la cohésion sociale.
Les priorités du Conseil fédéral à l’international ne sont pas moins cruciales :
· Renforcer la voie bilatérale avec l’UE ;
· Contribuer à la sécurité européenne et soutenir l’Ukraine ;
· Poursuivre l’engagement humanitaire mondial ;
· Favoriser la paix et la sécurité par les bons offices ;
· Garantir un cadre propice à la compétitivité et à l’innovation ;
· Protéger l’environnement et lutter contre le changement climatique ;
· Défendre la démocratie, le droit international et les droits humains ;
· Adapter le multilatéralisme et consolider la Genève internationale.
Ces axes visent à assurer la sécurité, l’indépendance et la prospérité de la Suisse, tout en renforçant son influence.
Mesdames et Messieurs,
Chers représentants de l’économie,
L’histoire le prouve : la Suisse a toujours su s’adapter. Au siècle des Lumières, nous avons embrassé la liberté de pensée, la raison et la science. Des Lumières à aujourd’hui, nous devons, avec l’Europe, innover pour rester à la hauteur de notre potentiel.
Dans ce jeu d’échecs mondial, la Suisse avance avec des atouts solides : sécurité juridique, main-d’œuvre qualifiée, formation d’excellence, place financière robuste, frein à l’endettement et marché du travail flexible.
Mais ces forces ne suffiront pas sans une implication collective.
L’économie n’est pas un spectateur de l’évolution du monde : elle en est une actrice clé.
Mesdames et Messieurs,
Votre rôle est crucial. Retrouvez la force et le courage de vous engager dans le débat public. Exprimez vos convictions, haut et clair. Rien n’est acquis par le simple fait de vivre en Suisse. Tout se gagne, tout se construit.
Votre voix, vos choix, votre innovation et votre engagement font la prospérité et la stabilité de notre pays. Soyez-en les artisans.
Ensemble, transformons les défis en opportunités pour bâtir un avenir durable, compétitif et prospère.
Nous en avons les moyens !
Même dans un jeu complexe et imprévisible, nous pouvons anticiper, avancer et jouer intelligemment.
Pas question d’être échec et mat !
La Suisse a encore de brillants coups à jouer – pour elle-même et bien au-delà.
Je vous remercie.