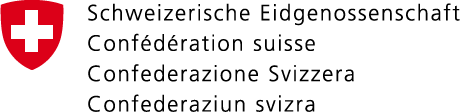Objectif 1: Sauver des vies et soutenir l’accès à des services de base de qualité
Les services de base comprennent notamment les infrastructures sanitaires, les soins de santé essentiels, une éducation de qualité et les systèmes de protection sociale. Les actions de la CI visent à améliorer l’accès, la qualité et la couverture de ces services, qu’ils soient fournis par des acteurs publics ou privés. L’amélioration de ces services, tels que ceux de l’éducation et de la santé, crée les conditions propices pour accéder à des formations de qualité qui conduisent à des emplois durables et à une vie publique active.
En cas de crises et de conflits, ces services essentiels ne sont souvent plus garantis. Par ses activités d’aide humanitaire, la CI suisse veille à ce que les personnes et les communautés vulnérables puissent subvenir à leurs besoins. La CI mène des initiatives bilatérales et multilatérales pour favoriser le respect et la mise en œuvre des principes et du droit international humanitaires dans les zones de conflit, et pour contribuer à la protection de la population civile. À travers ses activités de CI, la Suisse plaide également pour le respect des principes humanitaires auprès des acteurs engagés.
Compte tenu du contexte actuel, la stratégie 2025-2028 met l’accent, en ce qui concerne le développement humain, sur deux objectifs spécifiques, à savoir la migration et la santé.