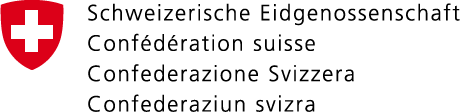Les transferts monétaires (TM) : Placer les personnes touchées par les crises au cœur de la réponse humanitaire

Les transferts monétaires (TM) sont une modalité de distribution de l’aide humanitaire, au moyen d’argent en espèces ou sous forme numérique, ou de bons d’achat. Les personnes touchées par une crise sont les mieux à même d’identifier leurs besoins les plus urgents. Les TM leur permettent de choisir en toute liberté les biens essentiels qu’elles achètent et d’accéder aux services de base selon leurs préférences. La DDC utilise les TM lors d’interventions d’urgence ou en cas de crise prolongée, dans tous les secteurs relevant de l’aide humanitaire : sécurité alimentaire, hébergement, soins de santé, approvisionnement en eau, assainissement ou éducation.
Focus DDC
En tant que pionnière dans le domaine, la DDC a réalisé plus de 30 projets avec une composante TM depuis la fin des années 1990. La DDC peut, par exemple, fournir de l’argent liquide à des familles pour couvrir leurs besoins après le passage d’un ouragan, ou pour se procurer des matériaux de construction sur les marchés locaux après un tremblement de terre.
La Suisse endosse trois rôles clés en matière d’aide humanitaire sous forme de TM. Premièrement, la DDC joue un rôle d’acteur à part entière et réagit aux catastrophes naturelles, aux conflits armés et aux crises prolongées en mettant en œuvre ses propres projets avec une composante TM. Elle soutient aussi les TM des principaux partenaires des Nations Unies et des ONG locales et internationales en déployant des spécialistes du Corps suisse d’aide humanitaire (CSA). Deuxièmement, elle mène des actions de plaidoyer et encourage activement la prise en compte systématique des TM et le respect des normes de qualité. Troisièmement, en tant que bailleur de fonds, elle finance des organisations partenaires qui mettent en œuvre des projets comportant un volet TM.
Une réponse humanitaire qui fait appel aux marchés et services locaux
Les biens de première nécessité tels que la nourriture et l’eau peuvent souvent être achetés sur les marchés locaux. Pourtant, les donateurs et les agences d’entraide ont toujours préféré envoyer des tonnes de matériel d’aide depuis leur propre pays vers les régions en crise. Cette façon de procéder peut avoir un impact négatif sur l’économie locale : les commerçants locaux sont confrontés à un afflux de marchandises et d’articles gratuits, avec lesquels ils ne peuvent pas rivaliser.
Les TM permettent aux acteurs humanitaires de travailler avec les marchés locaux, et de les soutenir. En privilégiant les marchés locaux par rapport au marché mondial, elle permet aux propriétaires de magasins ou aux agriculteurs de poursuivre leurs activités même en cas de crise. Le recours à des prestataires de services existants et l’incitation aux solutions locales peuvent également faciliter le redressement après une crise. Enfin, les TM permettent de réduire les coûts logistiques, ce qui contribue à diminuer la situation budgétaire tendue du secteur humanitaire. Il est toutefois important que les marchés locaux puissent faire face à l'augmentation de la demande.
L’analyse minutieuse de la situation du marché dans la région concernée constitue un élément clé pour réaliser une étude de faisabilité et concevoir un TM qui sera couronné de succès. Autre facteur important : un système de paiement fiable doit être mis en place, sans oublier les bénéficiaires et les communautés concernés, qui doivent bien évidemment être favorables à cette approche.
Contexte
Représentant actuellement un cinquième de l’aide humanitaire internationale, les TM se sont rapidement développés ces dernières années et remplacent progressivement la distribution de biens en nature. Mais son potentiel est loin d’être épuisé. Selon les recherches, si les TM étaient utilisés partout où cela s’avère possible, ils pourraient représenter entre 30 et 50% de l’aide humanitaire internationale. C’est pourquoi la DDC plaide en faveur d’une utilisation accrue de cette approche dans le cadre de l’aide humanitaire, tout en reconnaissant les risques potentiels ainsi que les défis associés à la mise en place de projets avec des composants TM.
La DDC fait partie du CALP Network, un réseau mondial qui regroupe plus de 90 organisations. En collaboration avec ses partenaires, elle s’efforce de diffuser les connaissances sur les TM auprès des acteurs humanitaires. Elle analyse également la possibilité d’utiliser les outils numériques et les nouvelles technologies.
Liens
Projets actuels
Aucun résultat trouvé