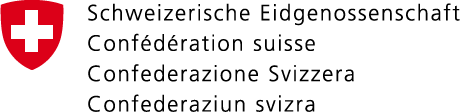La santé mentale : Une composante négligée de la paix
Malgré le plus grand nombre de conflits violents depuis la Seconde Guerre mondiale, la question de la santé mentale continue d'être largement négligée. Or l’instauration d’une paix durable ne se conçoit pas sans la prise en compte des besoins psychologiques et sociaux des communautés. Dans plusieurs pays en situation de conflit ou de post-conflit, la DDC appuie des réformes du système de santé et des initiatives locales en matière de santé mentale. Son action en Ukraine démontre particulièrement le potentiel de cette approche.

Dans le cadre de projets menés conjointement par la Suisse et l’Ukraine, des psychologues viennent en aide à des personnes déplacées dans des centres d’accueil répartis sur l’ensemble du territoire ukrainien. © DDC/Alisa Kyrpychova
« En ce moment, les gens sont plus anxieux, une anxiété qui se traduit par des troubles du sommeil et qui empêche certaines personnes de travailler ou de vivre normalement. Nous relevons déjà une hausse des troubles dépressifs », explique Tetiana Bohuslavska, qui travaille comme psychologue dans le cadre du projet « Act for Health », mené conjointement par la Suisse et l’Ukraine dans un pays déchiré par la guerre. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), une personne sur cinq ayant vécu une guerre ou un autre conflit au cours des dix dernières années souffre ou souffrira de dépression, d’anxiété, de stress post-traumatique, de troubles bipolaires ou de schizophrénie. Or l’instauration d’une paix durable implique de veiller à la bonne santé. Pour y parvenir, il est impératif d’appréhender les différents aspects des besoins psychosociaux.
Santé mentale et paix
Si les Ukrainiens sont habituellement peu disposés à chercher un soutien psychosocial, ils sont actuellement plusieurs millions à chercher de l’aide pour surmonter les épreuves de ces dernières années. Tetiana a été contrainte de fuir sa ville natale dans l’est de l’Ukraine. Engagée dans le rétablissement de la santé mentale de la population, elle estime que son action constitue une voie nouvelle vers une paix durable. « Pour moi, les notions de santé mentale et de paix sont indissociables. Et par "paix", je n’entends pas seulement l’absence de guerre, mais l’instauration d’un cadre pacifique propice à l’adaptation qui permette de soutenir les déplacés internes. » C’est aussi dans cette logique que les Nations Unies ont récemment souligné leur ambition de renforcer l’intégration de la santé mentale et du soutien psychosocial dans la consolidation de la paix, de façon à renforcer la résilience et la capacité d’action des personnes et des communautés, et à augmenter, demain, les chances de réussite du processus de réconciliation. Cette approche dépasse la période du conflit. En effet, les recherches scientifiques montrent clairement que les problèmes de santé mentale constituent un obstacle majeur à la réconciliation et à l’instauration d’une paix durable.
Importante réforme en Ukraine
Il est essentiel, pour l’avenir de l’Ukraine, de traiter les séquelles souvent invisibles laissées par la guerre. Les bombardements et les destructions de grande ampleur, les violences, les séparations au sein des familles, les déplacements, la perte d’êtres chers et les incertitudes ont pesé lourdement sur la santé psychique des Ukrainiens. L’OMS estime d’ores et déjà qu’ils pourraient être 9,6 millions à souffrir de problèmes de santé mentale – seul l’avenir permettra de connaître l’ampleur réelle du problème. Anticipant les conséquences dévastatrices que la situation pourrait avoir sur le tissu social, le gouvernement a mis l’accent sur le bien-être psychosocial et la résilience des personnes. C’est d’ailleurs pourquoi la santé mentale est une priorité nationale depuis 2014.
La DDC capitalise sur son expérience acquise à l’international pour compléter et soutenir l’action de grande envergure et au long cours engagée par l’Ukraine. Lancé en 2018 et porté par la Suisse et l’Ukraine, le projet « Mental Health for Ukraine » soutient la réforme du système de santé mentale en Ukraine et la création de centres spécialisés dans les régions, en collaboration avec les autorités, l’Université catholique ukrainienne, ainsi que des experts suisses de la Clinique universitaire psychiatrique de Zurich et de l’Université de Zurich. Récemment, il a été prolongé jusqu’en 2028, moyennant quelques adaptations pour suivre l’évolution rapide du contexte et l’augmentation des besoins psychosociaux. Les priorités ont également été revues : le projet prévoit désormais la réintégration des personnes souffrant de maladies psychiques, la fourniture d’un soutien psychosocial aux personnes vivant à proximité des zones de conflit ou aux déplacés internes, et l’amélioration de la coordination entre les prestataires de soins de santé mentale.
« Notre santé mentale est une composante éminemment importante de notre vie, mais elle est aussi très fragile, notamment en temps de guerre. Il n’y aura pas que les infrastructures et les villes à reconstruire en Ukraine. Il faudra aussi rebâtir notre santé mentale et les liens entre les personnes. Et les actions que nous entreprenons pour faire face aux conséquences de la guerre, aux épreuves et aux traumatismes sont un premier pas vers la guérison et vers la consolidation de la paix », explique Orest Suvalo, psychiatre et chef du projet Mental Health for Ukraine.

Des solutions locales et résilientes
Cinq jours par semaine, Tetiana Bohuslavska et plusieurs médecins se rendent dans des villages isolés et dans des centres d’accueil pour personnes déplacées. Menées dans le cadre du projet « Act for Health », qui est coordonné avec le plan d’action national et complète le projet « Mental Health for Ukraine », ces visites sont un moyen de combler les lacunes dans les services publics ukrainiens et de rapprocher les services de santé et les services psychosociaux de la population : les médecins effectuent des examens médicaux et Tetiana propose des consultations psychosociales privées.
« L’approche moderne de la santé devrait prendre en compte une composante biologique, soit un corps en bonne santé, une composante mentale, soit le bien-être psychique, et une composante sociale, soit la bonne insertion dans la société. Il y a actuellement une forte demande en services de santé mentale. Nous utilisons l’approche du rétablissement : le but n’est pas tant de traiter la personne pour qu’elle guérisse complètement, mais de lui apprendre à vivre de façon épanouie en composant avec le trouble dont elle souffre ou avec la réalité qui l’entoure », explique Tetiana.

Il faut renforcer les structures locales de façon à mettre en place des systèmes durables et flexibles. Les Hôpitaux universitaires de Genève fournissent l’expertise suisse là où c’est nécessaire. Afin d’améliorer l’offre de santé et de santé mentale au niveau local, le projet « Act for Health » a institué, dans quatre régions, des pôles de connaissances spécialisés dans les maladies non transmissibles, et en particulier dans les troubles psychiques, favorisant ainsi la mise en place d’une infrastructure et d’une expertise aussi durables que facilement adaptables.
Initiatives dans d’autres pays et plaidoyer mondial

La Suisse est l’un des rares pays à soutenir les interventions de santé mentale au niveau national dans d'autres pays, p. ex. en Ukraine, en Bosnie et Herzégovine, en Moldova et dans les pays de la région des Grands Lacs, et à s’engager simultanément dans le plaidoyer mondial et le dialogue politique pour faire avancer la cause de la santé mentale.
Élaborée notamment par l’OMS, l’Initiative spéciale pour la santé mentale vise à améliorer, au niveau local, l’accès à des services de santé mentale abordables et de qualité. Depuis son lancement en 2019, elle a abouti à des avancées en matière de politique de santé mentale, de plaidoyer et des droits de l’homme, ainsi qu’à l’extension des activités à neuf pays, dont le Bangladesh, le Népal et le Zimbabwe. À ce jour, l’initiative a aidé 44,7 millions de personnes et, face aux conséquences de la pandémie de Covid-19, elle a suscité l’intérêt d’autres pays à revenu faible ou intermédiaire.
Les données recueillies au niveau national sont utilisées en vue de la publication de travaux normatifs au niveau mondial, tels que l’Atlas de la santé mentale (2019/2020), le Programme d’action Combler les lacunes en santé mentale 2023 ou encore le Rapport mondial sur la santé mentale 2022, qui a fait date.
Bosnie et Herzégovine

Le fardeau que représentent les troubles psychiques en Bosnie et Herzégovine est un lourd héritage de la guerre et de la situation économique difficile. Le projet de santé mentale, lancé en 2009 et mené à bonne fin en 2023, a permis d’appuyer la réforme des soins de santé mentale. Il a été mis en œuvre par une organisation partenaire locale en étroite collaboration avec les institutions locales et avec les ministères de la santé des entités, à l’origine de l’initiative.
Axé sur la décentralisation de la fourniture de soins des hôpitaux vers des centres communautaires de santé mentale (Community Mental Health Centres, CMHC), le projet a concouru à la mise en place d’un réseau de 74 CMHC dotés d’équipes pluridisciplinaires. À l’heure actuelle, la quasi-totalité des CMHC sont entièrement financés par les budgets dévolus à la santé publique et ont l'intention de poursuivre leur travail.
Région des Grands Lacs

Depuis la fin de la période coloniale, l’histoire de la région des Grands Lacs est marquée par des violences de masse. Au Burundi, au Rwanda et en République démocratique du Congo, la DDC promeut l’approche communautaire « Guérir ensemble », qui agit sur le cycle de la violence (y compris les violences fondées sur le genre), corollaire des conflits. Par ailleurs, le dialogue politique met l’accent sur des messages de lutte contre les violences à caractère sexiste et sur la mise en œuvre de l’engagement pris par les chefs d’État dans la Déclaration de Kampala d’intégrer l’approche dans les politiques et les stratégies. Résultat : on assiste à un recul durable des violences, à la refondation de valeurs partagées au sein de la communauté et à une amélioration de la cohésion sociale, qui sont autant de préalables à une paix durable.
Amérique latine

Malgré d’immenses avancées macroéconomiques, l’Amérique latine fait face à d’immenses défis dans le domaine du développement durable : conflits armés, violences, fragilité et niveaux d’inégalité très élevés. Dans ce contexte et partant du constat que les conflits de longue durée et la violence endémique avaient engendré une culture de la peur et des traumatismes collectifs, obstacles au développement durable, le bureau de coopération de la DDC au Honduras a décidé de généraliser l’approche psychosociale à l’ensemble de ses projets. Cette approche, articulée autour de la dimension personnelle (sentiments, croyances, valeurs), de la dimension sociale (culture, relations) et de la dimension matérielle (pauvreté, environnement naturel et structurel), vise à renforcer la cohésion sociale et l’autonomie des organisations et des communautés ainsi qu’à surmonter la culture de la violence, les polarisations et les conflits sociaux.